On a beau avoir été déçu par le dernier James Bond, on débriefe ce qu’il y a de plus réussi dans le chant du cygne de Daniel Craig. Attention, article 100% spoilers !
L’intro façon slasher
Bonne idée, ça, de faire un pas de côté d’entrée de jeu. Cary Joji Fukunaga choisit d’ouvrir Mourir peut attendre avec l’une des rares scènes d’intro de l’histoire de la saga à ne pas impliquer James Bond : un souvenir d’enfance de Madeleine Swann, où la petite fille est prisonnière d’un chalet norvégien avec sa maman dans les vapes et un tueur complètement cintré à ses trousses. Le masque du méchant façon théâtre nô, les portes vitrées, l’enfant prisonnier sous la glace… Fukunaga joue avec les codes du slasher pour synthétiser les thématiques du run bondien de Daniel Craig et annoncer celles du film à venir (l’adieu à l’enfance, le refoulement émotionnel…), dans un registre de pure efficacité, plutôt que dans une sublimation arty à la Sam Mendes. Et tant pis si ça ressemble plus, dans les faits, au tout-venant de la production horrifique qu’à du John Carpenter : on peut aussi décider d’y voir un hommage aux années Roger Moore, quand les Bond se frottaient aux genres à la mode du moment (blaxploitation, kung-fu, SF, etc). Et si James Bond, en 2021, avait un petit parfum Blumhouse ?
Matera
Le pré-générique se poursuit avec une séquence surexcitante en Italie, impliquant un traquenard dans un cimetière (comme dans Rien que pour vos yeux), Léa Seydoux en larmes dans une voiture (comme chez Bruno Dumont), des courses-poursuites dingos utilisant merveilleusement la géographie de Matera, un Craig fou de colère et, pour conclure, une jolie chorégraphie d’adieux sur un quai de gare. Presque un court-métrage bondien auto-suffisant, violent et mélo, avant que Billie Eilish ne vienne refroidir l’ambiance. Casino Royale s’ouvrait par la meilleure scène d’action de l’histoire des Bond, Mourir peut attendre s’ouvre par la meilleure scène d’action de l’ère Craig depuis… l’ouverture de Casino Royale. La boucle est bouclée.
La retraite jamaïcaine de Bond
Parce que James Bond s’est posé beaucoup de questions ces dernières années, pleurant sa girlfriend suicidée, visitant les vestiges de son enfance dans la lande écossaise, on a rarement eu l’occasion de le voir simplement être… James Bond. Au naturel. Soit un hétéro blanc renfrogné dont le mode de vie est constamment tiraillé entre luxure et ascétisme. C’est ce Bond-là, à l’état sauvage, quasi préhistorique, qu’on entrevoit le temps de la séquence jamaïcaine de Mourir peut attendre. Un retour aux sources, donc, sur les terres caribéennes de Ian Fleming, où le charisme revêche de Daniel Craig fait des merveilles. Retraité, de nouveau célibataire, Bond erre dans sa maison d’architecte au bord de l’eau, s’abandonnant à une vie d’hédonisme sans joie. Quand il rencontre l’agent de la CIA Logan Ash (Billy Magnussen), il a instantanément envie de lui casser la gueule. Pourquoi ? Parce que celui-ci sourit trop… Daniel Craig, à qui ses détracteurs reprochent de ne savoir jouer 007 qu’en tirant la tronche, intègre ces critiques dans une très amusante variation pince-sans-rire sur son personnage. Définitivement le Bond le plus subtil depuis Sean Connery.
Ana de Armas
Ah, Paloma ! Notre agente à La Havane. L’apprentie espionne gaffeuse et rigolote. Celle dont tout le monde parle en sortant de Mourir peut attendre. Lors d’une séquence virevoltante, qui ressuscite le sens du fun et de la légèreté qu’on associe historiquement aux aventures de James Bond, elle fait souffler un irrésistible vent d’effronterie sexy sur un film trop souvent écrasé par son cahier des charges. Acolyte de 007 le temps d’un speed dating létal, arrosé au vodka martini, et où crépite l’ironie délurée de la scénariste Phoebe Waller-Bridge, l’actrice cubaine fait des étincelles et profite de son alchimie monstre avec Daniel Craig, déjà rôdée dans A Couteaux Tirés. Elle a également droit au meilleur décor du film – une simili-partouze à la Eyes Wide Shut, « visitée » par l’œil de Blofeld (rappelons que, dans 007 Spectre, la première apparition de l’ennemi juré de Bond avait déjà des accents kubrickiens). Ana de Armas débarque dans cette sauterie macabre en robe du soir, met tous les spectateurs dans sa poche en deux ou trois punchlines, distribue les high kicks en souriant, et pouf, elle est déjà partie. Le film aura d'ailleurs un mal fou à se remettre de sa disparition.
Les adieux à Felix Leiter
Des nombreuses réinventions offertes à la saga depuis Casino Royale, le Felix Leiter de Jeffrey Wright aura été l’une des plus réussies – et des moins commentées. Acteur génial partout où il passe, de Westworld à The French Dispatch, Wright a droit ici à une superbe sortie de scène, où Mourir peut attendre trouve la note idéale, celle qu’on aimerait que les Bond tiennent plus souvent : un équilibre parfait entre le pulp et la tragédie. Leiter va mourir, l’heure est grave, la mer est déchaînée, mais pas besoin de s’appesantir pour autant. Quelques mots suffisent pour les adieux des deux mercenaires aux mâchoires serrées par la douleur et le chagrin. « C’est une belle vie, non ? » - « La meilleure. » Gros, gros frissons… Salut à vous, monsieur Leiter.
Les Easter eggs
Un James Bond où il n’y a pas une, mais DEUX Aston Martin iconiques (la DB5 et la V8 Vantage de Tuer n’est pas jouer) peut-il être un mauvais James Bond ? Evidemment que non, répondent les puristes, qui se régalent des Easter eggs de Mourir pour attendre. Tous disséminés, il faut bien l’avouer, avec une certaine élégance. Les clins d’œil graphiques à Dr No au début, le « poison garden » du grand vilain Safin qui évoque le « Garden of Death » du roman On ne vit que deux fois, Bond rejouant le gun barrel « pour de vrai » en plein climax… Notre préféré ? Sans doute la galerie de portraits des anciens M, suspendus aux murs d’un vestibule du MI6, du vétéran Bernard Lee à Dame Judi Dench (la peinture semble encore fraîche). Chouette idée déco pour bondophiles de l’extrême.
Le running-gag sur l’alcool
Ça commence par l’image d’une petite fille obligée de servir des verres de vin à sa mère à demi inconsciente, qui tente de noyer sa peur panique dans l’ivresse. Puis il y aura les remarques désobligeantes de James Bond à M sur l’alcoolisme rampant du patron du MI6. Les verres de whisky que l’agent secret s’enfile compulsivement lors de sa rencontre jamaïcaine avec la nouvelle 007 jouée par Lashana Lynch. L’accord entre James et Paloma sur la nécessité d’une pause vodka martini avant de passer à l’action. La bouteille de rouge que Bond, ce gros lourd, débouche chez Q sans demander la permission… L’alcool est le fil rouge de Mourir peut attendre, tour à tour montré comme une délivrance et un poison, une échappatoire et une malédiction, finissant par fonctionner comme une métonymie du personnage de Bond lui-même, à la fois séduisant et très dangereux, indispensable et encombrant. Etonnamment, le film n’est d’ailleurs jamais aussi plombant que dans les scènes où personne ne boit un coup (toute la dernière heure et demi, en gros). A la fin, l’esprit du super-espion finira carrément par se matérialiser dans quelques centilitres de whisky : un dernier verre avant la fin du Bond.
Les derniers mots de Madeleine Swann
La voiture de Madeleine Swann serpente sur la route qui la ramène à Matera. "Je vais te raconter l’histoire d’un homme, dit-elle à sa fille Mathilde, assise à la place du mort. Son nom était Bond, James Bond." Une réplique d’ores et déjà inscrite dans la légende de 007. Quoi qu’on pense des différentes options prises par Mourir peut attendre pour "humaniser" le personnage (lui faire préparer le petit-déjeuner à Mathilde, lui faire combattre le grand méchant du film un doudou accroché à la ceinture…), quoi qu’on pense de l’idée même de la mort de James Bond, le moment où Madeleine Swann commence à chanter sa légende pour les générations futures est d’une incontestable puissance mythologique. "Les héros ne meurent pas, ils disparaissent dans l’espérance de leur retour", écrivait Francis Lacassin en 1986, dans sa préface à un recueil des écrits de Ian Fleming. Une phrase à méditer au son de We have all the time in the world, chanson d’Au Service Secret de Sa Majesté qui sert de leitmotiv musical à Mourir peut attendre et dont l’utilisation parachève ici un parcours pop-culturel long de plus d’un demi-siècle. Mal-aimé au moment de sa sortie, longtemps désigné comme le canard boiteux de la saga, le Bond millésime 1969 avec George Lazenby est devenu au fil du temps une sorte de trésor caché, puis une matrice esthétique pour grands cinéastes bondophiles (le Christopher Nolan d’Inception). Source, dès Casino Royale, du romantisme morbide de l’ère Craig, Au Service Secret de Sa Majesté (et son final déchirant sur une route serpentant, comme ici, au bord d’une falaise) est aujourd’hui désigné par Mourir peut attendre comme la pierre angulaire de la mythologie bondienne – du moins de l’idée qu’on se fait, en 2021, de la mythologie bondienne. Le Bond que pas grand-monde n’aimait est devenu le Bond de référence, la pièce du puzzle sans laquelle on ne comprend plus rien. C’est l’affirmation suprême de l’idée que la saga 007 ne se conçoit que dans une réécriture permanente de sa propre histoire. Et il faut reconnaître que c’est assez génial.

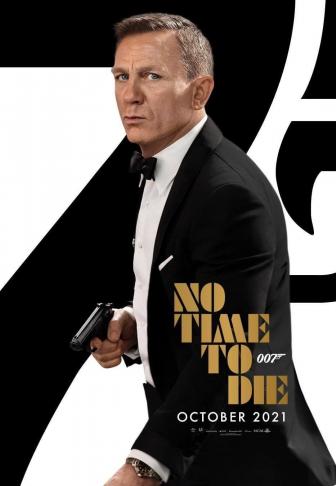
























Commentaires