Autour de la traque d’un assassin d’enfant, Fritz Lang dessinait un portrait visionnaire d’une Allemagne sous le joug d’Hitler. Il est visible dans sa version non censurée en deuxième partie de soirée, ainsi que sur Arte.TV.
L’image est iconique. Peter Lorre remarque de ses yeux globuleux un « M » dessiné à la craie sur l’épaule de son veston. Cette marque le désigne comme la bête immonde qu’il convient d’éliminer. M le Maudit de Fritz Lang (1931) s'inspire librement de faits réels, ceux d’un assassin d’enfants dans l’Allemagne des années 20, surnommé « Le vampire de Düsseldorf ». C’est le premier film parlant du cinéaste alors l'une des plus grandes stars du cinéma muet allemand (Metropolis, c’était lui !)
Arte.tv propose aujourd'hui la version de 2011, soit la plus proche de celle voulue initialement par Fritz Lang qui avait vu son film forcément « touchy », manipulé par les fourches caudines de la censure.
La fillette, la mère et l’assassin
Les premières séquences, elles, n’ont jamais bougé. Elles sont une leçon inégalée de montage et de tension dramatique. Fritz Lang montre en parallèle les actions d'une mère au foyer qui attend le retour de l'école d’Elsie, sa fille de 7 ans et le parcours de celle-ci sur le chemin de la maison. L’horloge sonne les coups magiques que l’on pressent d’emblée fatidiques. Il est l’heure. Le sourire de la mère traduit la joie de retrouver bientôt sa fille. Dans la rue, Elsie sautille sur la chaussée avec son ballon. Un policier veille à sa sécurité. En cuisine, sa maman prépare le repas. Le temps passe. Elsie n'est toujours pas là. Dans la rue, une ombre menaçante se penche sur la fillette. La mère entend des cris d'enfants dans l’immeuble. Elle ouvre la porte, se retrouve sur le palier et regarde par-dessus la rambarde. Un plan subjectif nous montre alors - en plongée - les rampes d'escaliers qui forment une géométrie stricte.

Secondes interminables. La mère rentre chez elle et se dirige cette fois vers une fenêtre. Elle hurle le nom de sa fille d'une voix déchirée et déchirante. « Elsie, Elsie… » Alors que résonne ce cri désespéré, Lang, implacable, décide de répéter le fameux plan en plongée des rampes d’escaliers. Celui-ci n'est plus la vision subjective d’une mère inquiète mais un plan purement mental. « Elsie, Elsie… » Cut. Voici maintenant des poutres bien droites entre lesquelles pend du linge. « Elsie, Elsie… » Cut. Une assiette creuse posée sur une table devant une chaise vide. « Elsie, Elsie… » La hache s’est soudain posée sur la « mère » gelée. Elsie ne reviendra plus. Notre mer intérieure, elle aussi, s’est pétrifiée sous les coups répétés de l’outil tranchant : le montage. Seul le cinéma peut provoquer un tel choc émotionnel grâce à un parfait agencement d’images.
Voyage au bout de la nuit
M le Maudit devient dès lors une chasse à l’homme dans une Allemagne prolétaire qui transforme sa paranoïa en soif de vengeance. En 1931, date de la sortie du long-métrage, le parti Nazi est aux portes du pouvoir et jouera, on le sait, sur la peur pour mettre en place le plus grand crime de l’Histoire de l’humanité. Lang n’aura le temps de réaliser qu’un autre long-métrage, Le testament du Docteur Mabuse (1933), avant de fuir son pays devenu invivable. En France d’abord puis Hollywood où il poursuivra sa carrière. Dès son arrivée sur le continent américain, il réalisera Furie (1936) avec Spencer Tracy, variation sur le même thème que M le Maudit. Une façon de dire que la folie des hommes est un mal qui n’a pas de frontières. Le critique et cinéaste français Jacques Rivette a écrit en découvrant le chef-d’œuvre de Lang : « M nous fait découvrir la culpabilité avec toutes les apparences de l’innocence. »
M le Maudit de Fritz Lang avec Peter Lorre. Dispo sur Arte.TV


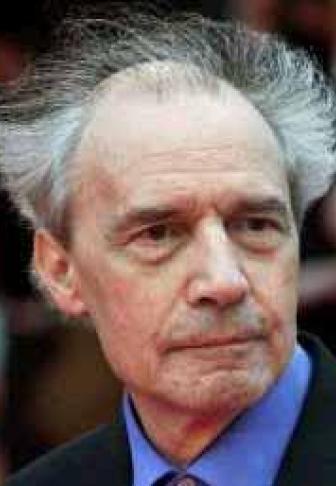




















Commentaires